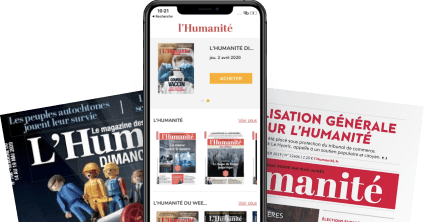Ou quelques réflexions sur la gastronomie au pays de Cro Magnon, Montaigne et Jacquou le Croquant… Un texte de Jacques Baleytier.

Depuis l’aube des temps gourmand !
En choisissant le Périgord comme résidence principale, nos ancêtres que l’on dit “des cavernes” ont oublié de se tromper ! N’en déplaise à certains, c’est bien ici que ces femmes et ces hommes venus, paraît-il, de ces “âges farouches”, ont décidé de s’établir. Et comment ces artistes capables de peindre ces chefs d’œuvres et de magnifiquement sculpter l’ivoire, auraient-ils pu se contenter de sordides mangeailles ? Les qualifier de “sauvages” est une plaisanterie… Je les vois, au contraire, en hôtes délicats, en raffinés gourmets et il ne me déplait nullement d’affirmer qu’au milieu de quelques pierres s’élaboraient déjà les bribes d’une gastronomie appelée à occuper les plus hautes des marches. En posant leurs derrières au bord de la Vézère, nos aïeux n’étaient point fous. Ils ont senti que cette rude mais belle campagne leur offrait d’idéales conditions pour satisfaire leur préhistorique gourmandise : gibier à profusion, chevaux, bisons, mammouths, bouquetins et plus encore rennes, offrant, à côté du garde-manger, de quoi fabriquer armes, outils, vêtements et bijoux,rivières poissonneuses, où les saumons abondaient à chaque migration, châtaignes des noix, qu’il suffisait de ramasser, innombrables champignons, goûteux à souhait, quantité de petits fruits et de baies, des truffes, en veux-tu, en voilà, et ce miel sauvage qu’Homo erectus récoltait joyeusement…
La domestication du feu a constitué, pour le palais de notre chasseur-cueilleur, une authentique révolution. Qu’elle soit embrochée, posée sur des cailloux chauffés ou glissée sous les braises, la pièce de viande révélait de toutes autres saveurs, qu’une poignée d’aromatiques herbes, médicinales pour certaines, décuplait… Et que dire de ces outres de peau emplies d’eau que l’on bassinait grâce à de brûlants galets, histoire de faire doucement cuire quelques morceaux de choix ! Prémisse du pot au feu… C’est donc en cette singulière et délicieuse contrée, si riche de bois et de forêts, de cours d’eau et d’étangs, de grottes et de plateaux, qui allait devenir le département de la Dordogne, que nos prédécesseurs du Paléolithique décidèrent de s’installer et de donner le coup d’envoi à notre tradition du bien manger, mais aussi du bien boire !
Sans vouloir offenser les autres gastronomies, c’est également en ce terroir et nulle part ailleurs que Montaigne a cru bon de disserter sur sa fameuse “Science de gueule” ! Un délicieux concept qu’il avait inventé dans la chaleur de la table, en compagnie vraisemblablement de son ami et voisin, cet autre grand gourmand de La Boétie. Et que dire de Pierre de Bourdeille, on l’appelait Brantôme, prolongeant le moindre des festins par un séjour dans l’alcôve avec ses Dames Galantes, ou de Charles Maurice de Talleyrand Périgord, prince de Bénévent, devenu virtuose dans l’art de mettre en scène le repas à des fins diplomatiques. Bien des années plus tard, André Maurois, natif pourtant de Normandie, notera de son côté que “le Périgord n’est pas seulement un pays où l’on mange bien, c’est un pays où l’on mange finement et où la cuisine est tenue pour un des Beaux-Arts”. Un propos pleinement confirmé par Maurice Edmond Sailland, ce critique culinaire fondateur de l’Académie des gastronomes plus connu sous son pseudonyme de Curnonsky, qui n’hésitait aucunement à saluer “l’une des régions de notre pays où l’on mange le mieux, et depuis des siècles”… Difficile, n’est-il pas, de trouver plus gouleyante et conviviale villégiature !
À la table des châteaux ou les paysannes aux fourneaux…
En dissertant sur les “origines seigneuriales de la gastronomie en Périgord”, l’abbé Julien n’avait pas tout à fait tort… Dans son église de Saint-Saud-Lacoussière, petit village célèbre pour sa Confrérie du cèpe et du veau sous la mère, ce brave ecclésiastique délaissait volontiers calice, patène et encensoir pour s’emparer de l’encrier et de la plume d’oie ! Au fil des pages, il s’amusait à consigner, sous le pseudonyme de Georges Rocal, l’histoire de sa province. Ayant, au grand dam de l’évêché, depuis longtemps oublié le péché de gourmandise – son évocation du “devant de dinde désossé, bourré de truffes”, que l’on ne devait jamais proposer à plus de six convives, “pour que chacun ait largement sa part” nous met l’eau à la bouche – cette fine fourchette se plaisait à méditer sur la cuisine de ce coin de terre qu’il chérissait. Et son ami le Dr Paul Balard de préciser qu’en Périgord, “la cuisine est toujours l’apanage des femmes et nous devons nous méfier de ces “hostelleries” où trône un chef à grande calotte blanche”…
L’époque a bien changé et les vestales se font rares derrière les fourneaux des restaurants, disparaissant presque lorsqu’il y a des étoiles ! Ce sont pourtant ces dames qui ont donné leurs lettres de noblesse à nos usages de table, même si c’était l’homme qui découpait la tourte et “tranchait le farci”… En cette vallonneuse contrée, les châteaux, manoirs et autres gentilhommières étaient légion, chaque nobliau voulant sa place forte, fut-elle des plus modeste. L’inventaire des Monuments historiques en recense près d’un millier. Pour s’occuper de leur assiette et si possible de leur libido, ces hobereaux n’hésitaient aucunement à enrôler les filles de leurs métayers, les plus accortes de préférence ! Les drôlesses devaient s’activer jusqu’à leur mariage, souvent même au-delà, pour contenter le maître et ses nombreux appétits… Dans la cuisine, dominée, comme au château des Bories, par l’imposante cheminée où un bœuf pouvait allègrement rôtir, ces servantes apprenaient à magnifier les plus beaux produits du terroir et à mitonner le gibier, privilège exclusif du seigneur… Gare au manant surpris à braconner ! Souvenirs de sangliers et de chevreuils rôtissant d’une pièce, de faisans, palombes ou perdrix, de bécasses tournant sur leur ficelle, de brochettes de petits oiseaux, de garenne et de lièvre à la royale. Tout cela copieusement agrémenté du diamant noir ! Quant les paysans se contentaient de raves, de châtaignes, parfois de glands, les seigneurs et leur cour se régalaient de ces cuisines lentement et longuement mitonnées au coin de l’âtre. Des cuisines prenant tout le temps nécessaire, à seule fin que dore comme il faut la grassouillette volaille, que réduisent les odorantes sauces, que s’entremêlent les sucs et qu’arrivent en nos narines de délectables fumets annonciateurs d’inoubliables agapes…
En a découlé une gastronomie paysanne qui, pour être encore un brin copieuse, y compris au quotidien et surtout dans chaque moment de fête, en appelle aux richesses du sol, des bois et des ruisseaux, à des cuissons prolongées, à des mariages de saveurs et à une riche palette de recettes se transmettant oralement. Elle est née dans les braises des grandes cheminées, sous les agiles doigts de nos fermières, pour transformer en merveilles les plus humbles denrées !
Une cuisine jubilatoire et généreuse
Façonnée à la fine et odorante graisse du canardou de Dame l’oie, la cuisine de nos quatre Périgord, n’en faisant d’ailleurs qu’un, est “sans beurre et sans reproche”. Cette pertinente remarque est à mettre au crédit de Curnonsky, ce chroniqueur que ses pairs avaient élu “Prince des gastronomes” !Il est vrai qu’en notre chère Dordogne, la cuisine est généreuse, partageuse et surtout jubilatoire. L’infernale mondialisation tuant nos traditions, aseptisant, standardisant et clonant à toute allure et à tour de bras n’a que peu de prises. On se méfie des hormones, du transgénique, des émulsifiants, gélifiants et autres stabilisants d’origine chimique. On leur préfère le naturel, l’authentique et l’on continue gourmandement de suivre les saisons, de valoriser les productions fermières et de se réunir tout autour de la table, sourire aux lèvres et joie au ventre ! Chez nous, on sait encore prendre le temps des plaisirs de la bouche et la gastronomie est érigée au rang des arts ! On aime se rassembler, en famille ou entre amis. On commente les mets, sans prétention, ni discours gastrosophiques. On sait lever le verre, le coude et puis le reste ! Se nourrir relève du plaisir, chaque jour renouvelé.
Pour les grandes occasions, l’abondance est de mise. Et pas question d’abandonner sa chaise avant la prune ou le fruit à l’eau-de-vie ! On se régale de soupes longuement mitonnées, de poularde ou de chapon, de veau sous la mère ou de cul-noir, de confits ayant sagement hibernés sous la graisse, de choux, de pommes cuites au four, de pâtés de perdrix, d’onctueux civet ou de lièvre à la royale, de ballottine de dinde, de friture d’ablettes, de sandre ou de brochet, de la dame au long bec que nos restaurateurs n’ont même plus le droit d’inscrire sur leur carte, de jolis bocaux de cèpes préparés par la grand-mère, d’une poêlée de giroles ou mieux d’amanites des Césars, d’une omelette bien baveuse, d’escargots farcis, de châtaignes blanchies, de délicieuses tourtières accompagnées de vin de noix et plus encore de ces truffes s’épanouissant, sans que l’on sache vraiment pourquoi, dans les ronds de sorcières et de ce trésor à nul autre pareil que j’ose intituler “Sa Majesté le foie gras” ! Et tout cela généreusement arrosé par l’un de ces nectars du vignoble bergeracois, riche de ses treize appellations.
En cette contrée où nos chers troubadours, d’Arnaut de Mareuil, à Bertrand de Born, ou de Giraud de Borneil, à Guilhem de la Tour, en passant par Jaufre Rudel, Elias Cairel ou Bernard de Ventadour, chantaient l’amour courtois, “fin’amor” en occitan, les festins associaient étroitement bonne chère et belle rime. Élégante façon de sustenter et le corps et l’esprit ! N’en déplaise aux culs serrés, rabat-joie et autres pisse-froid, prétendant sataniser le péché de gourmandise, le bien manger et le bien boire font encore partie de ces valeurs que l’on s’efforce de cultiver chez nous. À seule fin d’inonder nos papilles d’inoubliables flaveurs, d’enchanter nos palais, de les faire frémir, frissonner, tressaillir, palpiter, onduler, en un mot provoquer la jouissance ! En Périgord, nulle pénitence. Rien que bonheur, allégresse, félicité, délectation, euphorie, jubilation, quasiment de la liesse et de cette licencieuse béatitude qu’éprouverait la moniale en enlaçant le capucin… Un vrai coin de Paradis,en habit vert, blanc, noir ou pourpre, n’en finissant pas d’ensorceler nos mandibules !
La soupe et le chabrol
“La soupe de là-bas, affirmait Fulbert Dumonteil, un “païs” devenu chroniqueur gastronomique, c’est mieux qu’un potage, c’est un dîner, c’est un régal”. Ce “là-bas”, c’est un terroir. Bien vivant. On y trempe la soupe. Un rituel ouvrant tous les repas. Du plus simple aux plus grands, à l’ombre des feuillages, pour enterrer grand-père, baptiser le gouillassou ou marier la petite. L’assiette fumante fait office de dîner. On parle du souper. Votre buste penché, les coudes sur la table. Les effluves remontent. L’odorat et le goût ne font qu’un. Pas un mot. Le choc de la cuillère. Et cette longue aspiration. Pour manger chaud. Sans se brûler la langue.
Dans son ouvrage La bonne cuisine du Périgord – une véritable bible locale – Andrée Mallet-Maze, plus connue sous son pseudonyme de La Mazille, explique que “si l’on fait d’aussi bonnes soupes” en cette contrée, c’est parce que les autochtones “l’aiment” et “ne sauraient s’en passer“… Qui n’a humé ces merveilleux fumets s’échappant de la soupière dont le fond a été tapissé de pain rassis, provenant s’il vous plait d’une miche et non d’une baguette, ne pourra comprendre ! Quelques règles permettent de magnifier ces solides brouets qui mariaient, au rythme des saisons, toutes les plantes potagères, s’amourachaient d’herbes fraîches, s’encanaillaient, à l’occasion, d’une épaisse couenne un brin rance, d’un reste de jambon ou de la carcasse de canard, d’oie ou encore de dinde que l’on nomme “baladuche”, voire d’une vieille volaille…
Il y a d’abord la “fricassée”. Elle arrange joliment. Demi-heure avant la fin, puisez dans la marmite en laissant de côté les farineux, les secs. Sortez raves ou poireaux, oignons ou bien carottes, navets, oseille et choux, haricots verts, petits pois, tomates, céleris, ail, verdure, aubergines, poivrons. Dans une grande poêle faîtes les rissoler, la tradition réclamant la graisse d’oie. Pincée de farine qui va roussir un peu. Louche du bouillon et brindilles d’épices. Quelques minutes encore. Pour exprimer tous les sucs. Reversez dans la gamelle. Préparée avec les légumes déjà cuits, la fricassée s’apprête également avec les hôtes crus du potager.
Il y aussi le farci, soigneusement emmailloté dans la feuille de chou ou fourré dans le ventre de la poule. De la mie de pain, malaxée dans du lait. Vous liez aux jaunes d’œufs. Ajoutez, à votre gré, petit hachis de viande. Porc ou veau. Fines herbes, touffe de persil, plat bien sûr et non frisé, ail, échalotes, sel, mignonnettes de poivre. Maniez bien. Une fois cuit, coupez de larges tranches d’un jaune bien doré. Bien sûr, vous ferez le chabrol. Si je n’en fais pas un décret, je le tiens néanmoins pour presque obligatoire. Surtout quand le bouillon est gras. Il en reste un peu dans le fond de l’assiette. Avec des yeux qui vous sourient. La bouteille de vin rouge est déjà sur la table. Servez-vous une belle rasade. Elle recouvre la cuillère que vous aurez discrètement tordue faisant pester votre moitié ! On remue et on boit en oubliant cette fois la cuillère. Soupir d’aise et grand geste de l’avant bras pour essuyer vos lèvres… Un vieux médecin de mon quartier n’hésitait pas à prescrire cette revigorante coutume sur chacune des ordonnances !
Quelques bonnes soupes
Particulièrement économique, mais tout ce qu’il y a de goûteux, le tourin est l’une des plus traditionnelles soupes de mon cher Périgord, excitant l’appétit et mettant de bonne humeur pour le restant du jour ! Certains le font à l’ail, quand d’autres ne jurent que par l’oignon. On peut mêler les deux, adjoindre des tomates et même un peu d’oseille. On peut également le “blanchir”, en ajoutant des œufs. Finalement, chacun a sa recette, mais les gourmands se gardent d’oublier le pain rassis. Dans une grande poêle, faite doucement revenir, dans la noix de graisse qui chantonne, les oignons ou bien l’ail écrasé, sans qu’ils prennent de couleur. Saupoudrez de farine et laissez blondir. On délaye d’une louche d’eau bouillante, mieux encore d’un bon et odorant bouillon, et on verse le tout dans le liquide frissonnant. Pour être parfaitement digeste, il doit cuire au moins une grosse demi-heure. Avec, si l’on veut, des tomates épluchées, écrasées et soigneusement épépinée. Au terme de la cuisson, il est possible d’en appeler à deux ou trois pincées d’oseille droit venues du potager.
Pour le tourin blanchi, à l’ail de préférence, c’est également vers la fin que l’on baisse le feu et que l’on ajoute des blancs d’œufs prestement battus. Brassez très vigoureusement, salez, poivrez à votre guise. Juste avant de servir sur les tranches de pain, vous incorporerez un jaune délayé dans un peu de vinaigre, voire dans du verjus. Il va lier ce rustique apprêt. En augmentant les jaunes, l’ensemble se fait nettement plus crémeux.
La soupe de carcasse n’est pas mal non plus, mon attirance allant vers celle du canard gras ! On la nomme “demoiselle” et l’on s’en régale tout simplement grillée et dégustée à pleine main juste au sortir de la braise… Dans la vieille marmite, quelques litres d’eau froide viennent recouvrir votre carcasse. Dès les premiers bouillons, un bol de haricots, mis à tremper la veille, deux oignons avec clou de girofle et petit bouquet garni ne sachant oublier la feuille de laurier. Près de deux heures de très douce cuisson ne seront point de trop avant d’incorporer carottes, poireaux, navets, gousses d’ail, branches de céleri et quelques côtes de bettes, le tout coupé en petits dés. Au bout d’une nouvelle heure, c’est au tour d’un joli cœur de chou, taillé et blanchi au préalable. Ne reste qu’à patienter, en vérifiant soigneusement l’assaisonnement. Servie brûlante sur du bon pain, elle réconforte les plus dépressives mandibules !
Passer à côté de la roborative soupe de haricots couennes serait faute de goût. En dépit des tranches de pain lestant encore un peu plus l’estomac, il est bien difficile de résister à la seconde assiette ! Même chose pour celle que l’on déguste lorsque l’on tue le cochon. Dans l’eau où a cuit le boudin, on ajoute quelques légumes, ceux du pot-au-feu, et la compagnie de savourer joyeusement ce délice appelé, en fonction des terroirs, jimboura ou bougras.
La diablesse m’ensorcelle !
“Qui dit truffe prononce un grand mot”, disait Brillat Savarin. S’il existe une centaine de variétés, seule une petite dizaine offre plus ou moins d’intérêt. Parmi elles, il n’en est qu’une valant, à mes yeux et surtout à mon nez et mon palais, d’être louangée ! C’est celle que l’on trouve chez nous, en hiver, la noire du Périgord… On l’aime, c’est “notre plus belle fille”, tout en précisant : “elle a mal tourné, puisqu’elle s’est faite aimer de tout le monde”… Aux temps où l’on récoltait plus de 1.000 tonnes par an, dont 200 rien qu’en Dordogne, il n’était pas rare de la consommer en accompagnement. Une livre de ce “merveilleux tubercule”, comme le surnommait Curnonsky, suffisait tout juste pour farcir dinde ou chapon. Et les vieux ouvrages de cuisine parlent même de ces “quelques” truffes rajoutées pour améliorer l’ordinaire !
Le Moyen-Âge cultiva l’ambiguïté… La truffe, soit dit en passant de Bourgogne, figurait en goûteuse place lors du mariage d’Isabeau de Bavière… Installés en Avignon, les Papes en firent une consommation nullement sage alors que l’effroyable Inquisition la vouait au bûcher, attribuant à Satan cette “bave noire et dure” et aux ballets des sorcières ces maudits cercles où l’herbe semble brûlée. Avec la Renaissance, notre donzelle retrouve droit de cité. François 1er la vénère, à l’égal de Catherine de Médicis. On cédera très vite aux charmes de ce que Rossini appellera “le Mozart des champignons”. Dans ses dévergondages libertins mêlant allègrement plaisirs de chère et de chair, la Cour avait en tête les vertus aphrodisiaques dont ce “présent des Dieux” était censé être paré. La faculté de médecine d’Avignon déconseillait du reste sa consommation aux personnes devant mener chaste vie ! Avant de pénétrer dans le boudoir, la Marquise de Pompadour, la comtesse du Barry, tout comme Casanova, savouraient quelques truffes chaudes. Brillat-Savarin, de son côté, affirmera que ce mets, qui “éveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant robe et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant barbe”, pouvait “en certaines occasions rendre les femmes plus tendres et plus aimables les hommes”.
Il est vrai que la diablesse ensorcelle et donne, comme le constate Pierre Gagnaire, “le tournis à tous ceux qui l’approchent”. Humer ses envoûtants parfums, où se retrouvent sous-bois, fruits secs torréfiés, concrétions minérales et sécrétions animales, échauffe tous mes sens… Une lamelle sur un morceau de bon pain légèrement toasté, avec filet d’huile d’olive – certains préfèreront beurre, graisse d’oie ou huile de noix – et fleur de sel, est pur enchantement ! La baveuse et rustique omelette ou l’élégante brouillade ne sont pas mal non plus. On pourrait encore évoquer les écailles dans le sandre, les râpures sur les morilles, le flan d’artichauts, le gratin de cardes ou de salsifis, les ris de veau, les pâtes ou la purée de pommes de terre, de céleri-rave ou de topinambours, le braisage au champagne, la mâche et ses lamelles, en se méfiant comme de la peste de l’excès de vinaigre… Or de question évidemment d’oublier la sauce Périgueux, la vraie, celle qui s’offusque de la présence de dès de jambon, de champignons ou de beurre, qui préfère le vin blanc au madère et qui nappe si divinement le filet de bœuf,les œufs pochés, le vol au vent ou le perdreau… Décidément, la belle n’a pas fini d’émoustiller nos mandibules !
La bécasse, ou le plus distingué des rôtis…
La suprême jouissance, en matière de gibier, découle selon moi de sa majesté la bécasse ! Orgasme et volupté, charnel libertinage pour papilles d’autant plus polissonnes que la commercialisation de cette adorable migratrice est totalement prohibée…
“Pour son fumet délicieux, la volatilité de ses principes et la finesse de sa chair, elle est recherchée par les gourmets de toutes les classes”, affirmait non sans raison Alexandre Dumas, dans son Grand dictionnaire de cuisine, où l’on découvre rien moins qu’une douzaine de recettes. Visiblement jaloux, l’ami Bocuse en dévoilait quatorze dans sa Cuisine du gibier ! Impénitent chasseur et fort habile cordon bleu, le sieur Eléazar Blaze proclamait, pour sa part, qu’“une bécasse cuite à point, placée sur sa rôtie dorée et onctueuse, est un des morceaux les plus délicats et les plus savoureux qu’un galant homme puisse manger”. Quant à Grimod de la Reynière, inventeur s’il en est de la prose gastronomique, il écrivait à juste titre : “On vénère tellement ce précieux oiseau qu’on lui rend les mêmes honneurs qu’au grand lama ; c’est dire assez que ses déjections sont non seulement précieusement recueillies sur des rôties mouillées d’un bon jus de citron mais mangées avec respect par de fervents amateurs”. Et d’ajouter : “Il est essentiel de se servir de sa fourchette en cette occasion dans la crainte de se dévorer les doigts s’ils ont touché à la sauce”…
Que d’honneur, diront certains, pour une créature couleur de feuilles mortes ne pesant guère plus de quatre cents grammes, nichant au ras du sol, s’affirmant échassier quand ses pattes sont si courtes, se nourrissant de vers, de larves et puis d’insectes et dont le nom est synonyme de dinde, cruche, gourde, oie blanche, en un mot sotte personne ! Et ne parlons pas de sa cousine bécassine rappelant cette pauvre soubrette native de Bretagne, aussi niaise qu’étourdie !
Oui, mais voilà… La belle est discrète et maligne. À en croire braconniers et chasseurs, cette dame au long bec est, de tous les gibiers portant plumes, la plus difficile à tirer. Excellant dans l’art du mimétisme et s’activant au crépuscule, notre donzelle aux grands yeux s’envole en zigzaguant… Bruissement d’aile et elle s’enfuit en changeant de direction aussi brusquement que la donzelle refusant la montée du plaisir après l’avoir longuement provoquée !
Il fut des temps barbares où celle qui inspira peintres, romanciers et poètes n’était consommée que faisandée. Cette pratique consistant à laisser se décomposer l’animal jusqu’au verdissement complet de l’abdomen corsait certes cette “divine nourriture” ! Putréfaction en vérité que ce brave Curnonsky osa dans les premiers qualifiait “d’erreur gastronomique “ ! Quatre à cinq jours au frais suffisent amplement.
Pour apprécier comme il se doit ce que Grimod nommait “nec plus ultra des jouissances humaines”, je recommande de pendre notre vestale juste plumée au bout d’une ficelle au-dessus de rougeoyantes braises. Chêne, hêtre, acacia ou pommier… La mordorée, c’est ainsi qu’on la surnomme, ne sera point vidée, exception faite du gésier. Au fur et à mesure, les intestins s’écoulent. On les recueille sur des tranches de pain rôties. La cuisson dure un gros quart d’heure. La chair doit rester rose. On finit d’étaler le fruit de ses entrailles enrichi au besoin de foie gras et d’une lichette d’armagnac. On tranche le céleste volatile et l’on déguste en silence !
Une volaille farcie
Jeter son dévolu sur la gent picoreuse capable de ravir vos papilles n’est pas des plus aisé. J’écarte évidemment ces pauvrettes ignorant les galipettes, les grands espaces, l’eau vive et l’herbe tendre, l’odeur du maïs et la saveur du vermisseau. J’opte pour celles élevées librement en ces pays où la terre est bien riche et prodigue le grain. On y éduque, “d’excellents élèves” notait Grimod de La Reynière en ajoutant : “Ne s’agit que de savoir les bien conduire, et c’est art qui n’appartient pas à tout le monde : une excellente fille de basse-cour est plus rare qu’une bonne danseuse”.
Quand paraît la basse-cour, m’arrivent tout de suite des images de farce. Quelque chose de joyeux, d’opulent, avec mille et une saveurs inondant les cuisines. C’est bien plus qu’un appoint, c’est toute autre manière de déguster un vrai poulet de ferme, une maîtresse oie, une grasse poularde sacrifiée encore vierge ou notre androgyne chapon occis toujours puceau… Tout, je le sais bien, est affaire de goût. Pour autant, présenter l’enfant des basses-cours avec la panse vide relève du crime de lèse-gourmandise ! Dans mon terroir périgordin, même un marmiton n’oserait s’y risquer… Omettre de farcir la donzelle ou le mignon est faute gustative. Aussi grave que de déboucher un vieux Monbazillac sur la boîte de sardines !
Si chaque cuisinière a sa propre recette, toutes me semblent s’accorder sur de la mie de pain, prélevée de préférence dans une tourte déjà un peu rassis. Elles la mouillent avec du lait, parfois coupé de bouillon. Elles ajoutent bouts de lard, hachis de jambon ou de viande de porc, jaunes d’œufs, sel, poivre et quatre-épices, ail, échalotes, trompettes des morts, persil et fines herbes. Quelques châtaignes, enrichies pourquoi pas de brisures de marrons glacés, ne gâtent rien. Et pas davantage le foie de la bestiole mêlé d’une once de foie gras et d’un brin de veau soigneusement haché. Dans le farci de certaines, un soupçon de muscade et la lichette d’eau-de-vie. Il fut de béates époques où l’on n’hésitait point à en appeler à plusieurs livres de ce diamant noir que Rossini appelait “le Mozart des champignons”… Ces farces-là, que l’on dit blanches, sont du reste tout ce qu’il y a de plaisantes lorsqu’elles sont emballées dans les feuilles du chou et mise tout doucement à cuire. Dans les fermes, on aime adjoindre le sang. Cela devient la farce noire.
La rustique mais savoureuse mique…
On prétend frustre et grossière cette espèce de grosse boule de pâte à pain levée. Il est vrai que cette rustique pitance juste bonne à rassasier le manant ne figure point dans les recettes codifiées par ce bougre d’Escoffier, que continuent de magnifier une poignée de nostalgiques maîtres queux ! Préparée comme il se doit par quelques habiles mains, elle est, j’ose le dire, tout ce qu’il y a de plaisant. Économique en diable, elle se compose, à l’égal d’ailleurs de son compère le chou farci, d’ingrédients simples, de ceux que l’on découvre dans la plus humble des métairies. La qualifier d’“étouffe chrétien” me parait excessif, même si je reconnais qu’elle a tout pour sustenter un solide gaillard !
Ce mets, essentiellement familial et dont les savoir-faire se transmettaient de mère en fille, varie légèrement du terroir de Nontron à celui de Sarlat, s’estimant dépositaire de l’authentique tradition… “La mique, c’est le Sarladais” affirme ainsi Zette Guinadeau-Franc dans son délicieux ouvrage Les secrets des fermes en Périgord noir. Et la gourmande d’ajouter : “c’est la bourrée dansée en sabot que vous mettrez sur plat et que vous savourerez, comblé, les coudes sur la table”.
Avant de mettre à cuire une courte demi-heure, il vous faudra mélanger les farines, la rousse du maïs, malheureusement passée de mode, et la blanche du froment, voire la grise du seigle, avec des dés de pain rassis et de lard frais. Des puristes affirment que seul le pain, quignon et croûte, doit être pris en compte, la farine ne venant qu’à la fin pour assurer la consistance. On mouille d’un peu d’eau tiède ou de lait et on pétrit d’une main vigoureuse avec levure de boulanger, jaunes d’œufs battus et blancs en neige, graisse d’oie, sel et poivre. L’heure est venue de former une jolie boule, souple mais ferme, que l’on laissera lever plusieurs heures durant. Autrefois, les fermières, avant de s’en aller aux champs, la glissaient sous l’édredon de plumes et la récupéraient midi venu. Une fois cuite, la mique se retourne toute seule. De plaisir assurément ! Quelques minutes de patience et ne reste qu’à la trancher. De grâce, oubliez le couteau, vous l’écraseriez. Le mieux est d’user de deux fourchettes, pour écarter tout doucement. Apprêtée avec le pot au feu, la poule au pot ou le petit salé, la diablesse fera également merveille en accompagnement du confit, de la daube ou du civet.
Mais vous pouvez tout autant faire prestement revenir de belles tranches dans la noix de graisse, d’oie ou de canard, et savourer froides ou chaudes. Plongées dans l’œuf battu et mises à frire, elles se feront enfin dessert plébiscité par les enfants aussi bien que par les grands. Surtout n’hésitez pas à les saupoudrer de sucre, vanillé au besoin, ou à les enrober de confiture, de gelée de fruits rouges ou encore d’un bon miel du pays… Qui osera maintenant traiter de lourdaude et d’empotée cette délicieuse roturière capable de tenir la dragée haute à bien des plats sophistiqués ?
L’enchaud du Périgord
C’est un simple morceau de porc. Tranché à hauteur de la longe. Et braisé bien couvert. Un rôti, direz-vous ! Mais quel rôt. Digne des plus respectables mâchoires. Dans mon pays, on l’appelle l’enchaud. Les Périgordins s’en régalent. Avec ce mets, vous enchanterez une troupe d’amis, pour un pique-nique de vacances. Pas moins de quatre livres, prélevées sur l’animal à queue tirebouchonnée dont on parlait avec respect, en disant “lou moussur”, autrement dit “le Monsieur”, chaque ferme ayant le sien sacrifié en hiver à la lune montante.
Votre aimable boucher aura mis de côté la pointe du filet, là où le dos s’incurve. Plus haut, ce sont les côtelettes, propices à la grillade. Dans le panier, glissez aussi deux des pieds du verrat, de l’ail, de quoi faire un bouillon et les herbes du jardin.
D’abord, étalez bien la viande. À même la grande table. Frottez d’ail, salez, poivrez gaiement, sans trop de retenue. N’hésitez pas à le larder de gousses. Vous le roulez, avec feuilles de sauge. Vous l’attachez, serré. Comme tous vos rôtis. Au frais, dans un torchon, il va se reposer toute la nuit durant. Histoire de s’imprégner de toutes les senteurs.
Dans le fond d’une cocotte, faites fondre du lard, plus épais que la main d’un joueur de pelote. Quand la graisse pétille, tombée d’échalotes. Elle rissole un instant. C’est au tour du goret d’acquérir des couleurs. Qu’aucune face n’échappe à ces rayons de soleil sortant de la marmite. Et tant mieux s’il se forme une enveloppe, croustillante et dorée. Une flambée d’eau-de-vie va corser l’appareil. Un verre de bouillon, bien aromatisé – la sauge y domine, mariée à de la menthe, aux fleurs de marjolaine, à des raclures de muscade, à un clou de girofle. Ne soyez pas ingrat, un Côtes-de-Montravel élevé sur la terre de Montaigne ne lui fera aucunement misère.
Le rôti est mouillé. Encore sel, poivre, des aulx dedans leur peau et les arpions de la rose bestiole, fendus et blanchis au préalable. Dans le four qui va doux, placez votre faitout soigneusement couvert. Il vous faut, très régulièrement, entrouvrir. Pour tourner, arroser, titiller, inspecter. Difficile d’être précis sur la durée de cuisson. Deux heures au minimum. Et trois au maximum. C’est fonction du degré de chaleur, du récipient, du niveau du liquide et de tant d’autres choses relevant du coup de main…
Vous pourrez le manger à l’instant, tel qu’il est, juste entouré de petites pommes de terre en minijupes des champs. Avec le jus, légèrement dégraissé pour ne point trop fâcher ce vilain cholestérol, nappez l’odorant rôt. Il gagnera cependant à un brin de patience. Refroidie, la graisse s’est figée, tout autour de la viande. La rendant plus moelleuse et plus tendre, plus délicate, plus savoureuse.
À l’ombre d’un noyer que certains redoutent, une belle et grande nappe que je recommande de lin blanc. Elle est étendue sur l’herbe verte. Les amis vous regardent procéder au tranchage. Ils savourent des yeux aussi bien que du nez. Et bientôt des papilles. Près de vous, on taille la grosse miche. Une vraie tourte de campagne qui a rassis un peu. Au fond de la braisière, il reste de quoi napper le pain. Ne manque plus que la salade et la lampée de vin rouge, un Pécharmant cette fois, de derrière les fagots…
Une poêlée de cèpes
Une envie, brusque et gourmande. Elle s’ébauche par la vue, grandit par l’odorat, irrigue les papilles, enflamme tous les sens. Les images défilent, puis viennent les saveurs. J’avais eu vent que de l’humide sous-bois sortaient de joyeuses cohortes. Les froidures s’approchant, il s’agissait assurément des dernières pousses de la saison. Flânant sur le marché, je les vis tout de suite. De plein paniers de son excellence le cèpe que l’on dit de “Bordeaux”, boletus edulis pour les admirateurs de la langue de Virgile. Sans vouloir offenser mes voisins, j’ose déclamer ma nette préférence pour ceux dénichés sous les feuillus de mon cher Périgord. Bien charnus, sur leurs pieds ventripotents. Était aussi présent son admirable compère aereus, plus communément nommé tête de nègre. Plus fermes que les fesses de ma mie, sombres comme la nuit, ces bolets-là fleurent l’humus, la fougère, les bruyères et la mousse. Rien de leurs pâles neveux se développant sous les charmes, les peupliers, les bouleaux ou les mélèzes. Comment aurais-je résisté ?
N’en déplaise aux maniaques du microbe, la bassine est à proscrire. Comme l’est le blanchiment dans l’eau bouillante salée et vinaigrée conseillé par quelques vieilles cuisinières. Une façon, disent-elle, de faciliter la digestion. À défaut, insistent-elles, il faut “prendre son temps”. Et de recommander une “cuisson à l’étouffée, d’une heure et demie à deux heures”… La cuisine paysanne mérite le respect. Pourtant, cette abondance de liquide tout autant que de quarts d’heure me paraît dommageable. Mes mâchoires sanglotent quand ces trésors fragiles et délicats poussant en une nuit sous les rayons de lune deviennent aussi flasques et visqueux qu’une limace sous l’orage ! Les pauvres en perdent leurs parfums…
En contemplant les plus jeunes, les plus trapus, désir de couper des lamelles un peu grosses. Vinaigre balsamique et la pression à froid des fils de l’olivier. Au-dessus, copeaux d’un authentique parmesan. Dans l’assiette, un charmant lit de mâche… Longue hésitation, par contre, pour apprêter les autres. Braise ou flamme, four ou cocotte, provençale ou béarnaise, en passant par la bordelaise et le gratin, kyrielle de recettes. Autour de moi, les conseils vont bon train. On parle omelette, on suggère la poêlée, on apporte gousse d’ail et poignée de persil, on me tend l’échalote ou les pommes de terre. Les adeptes de la graisse d’oie le disputent aux fanatiques du beurre. Et s’égosillent les partisans de l’huile…
J’ai choisi, cette fois, de les faire sauter. Filet de bonne huile coupée d’un dé de beurre. Dès les premiers chuchotements, j’incorpore les hôtes du sous-bois. Je remue avec ail et persil. Je patiente en évitant de couvrir. Les gouttelettes de buée ramolliraient les chérubins ! Au tout dernier moment, pincée de gros sel et deux bons tours de moulin. Sur le feu, à peine quinze minutes. Au-delà, c’est offense !
Si les amis ont pris de la bouteille, avec barbichette virant au vert, le feu est nécessaire. Graisse d’oie dans les chapeaux, avec petit hachis légèrement aillé. Les pieds, tombée d’échalote, mie de pain, herbes fraîches, sel et poivre et, à seule fin de rehausser l’ordinaire, miettes de ventrèche ou de jambon. Tout à la fin, lichette de verjus. Dans les verres cette fois, je privilégierais volontiers quelque vin rouge aux arômes giboyeux et aux tannins fondus. Un régal qui pousserait, je vous l’affirme, l’impénitent bigot au vil péché de gourmandise…
Royale pour le lièvre
Les feuilles de la vigne vont se parer de roux. Les palombes s’approchent. La sauvagine n’est pas loin. Sur le dernier fourneau, je ne résiste pas à concocter ce plat, gigantesque et sublime. Sûrement le plus grand de la gastronomie. Créé pour les plus sensuelles bouches, sa trace se retrouve dans les très beaux grimoires. Elle est dans les mémoires et dans la tradition des cuisinières de mon pays. Celles des fermes noires, comme la chair du lièvre. La recette est mélodie. Ou plutôt, symphonie. De goûts, de couleurs, de parfums. Elle doit hanter vos jours, et obséder vos nuits.
Avant même le marché, choisissez vos amis. Ecartez, d’un revers de la main, tous les pisse-vinaigre, les ventres gris, les trognes tristes, ou les Dupont-Lajoie des gargotes françaises. Ils ne méritent pas même de sentir. Le lièvre à la royale se savoure entre gens de haute compagnie, partageant avec vous les plaisirs de la table, où tous les sens s’aiguisent, dont celui de l’amour. Un mets rabelaisien. Il se déguste avec civilité. Sur nappe de lin blanc. Couverts en argent, assiettes de porcelaine, verres en cristal pour accueillir l’antique Pécharmant ou le Montravel en habit rouge.
Un capucin, du foie gras, des rondelles de truffe, une belle bouteille, du vieux bas-armagnac, l’eau de vie de l’ancêtre et des petits légumes. Ce rouquin à poil luisant – vous l’aurez choisi jeune, un trois-quarts, n’excédant point six livres – va rassir une courte semaine dans une pièce obscure mais aérée. Videz-le, en préservant le foie, en réservant le sang que vous coulez dans un bol, avec filet de vinaigre. Par les pattes, suspendez l’animal, en lui laissant sa peau. Et glissez dans son ventre, thym, sauge, romarin.
Après avoir dépiauté le gibier, l’heure aura sonné de désosser la bête, de lui donner couleur.
Graisse d’oie s’il vous plaît ! Une daubière de bonne dimension. Je les aime en terre cuite, l’intérieur vernissé, à la forme du lièvre. Sur du lard de poitrine, blanchi au préalable, couchez donc maître Couart du Roman de Renard, enveloppé d’un linge. Carottes, gousses d’ail et oignon légèrement revenus. Grains de poivre et de genièvre, les deux clous de girofle, branche de céleri et le bouquet garni. Armagnac pour flamber. Pour mouiller, deux bouteilles de bon vin, rouge, bien sûr, et corsé. Et un doigt de vinaigre, mieux encore de verjus. Couvrez bien et glissez, pour deux heures, dans le four de votre boulangère. Après le pain, quand la chaleur est sage.
Retirez et ouvrez le torchon. Avec un beau foie gras et des morceaux de truffes, farcissez l’animal. En ajoutant, pour compléter, fin hachis, cuit avant, noix de veau, jambon, foie du lièvre et des restes de lard. Emmaillotez, en serrant bien. Dégraissez, puis filtrez l’odorant liquidede cuisson. N’omettez pas de presser les légumes. Remettez dans la braisière, en rajoutant, au besoin, du bouillon, puis replacez au chaud.
Le temps ne compte plus. Je l’oublie une demi-journée. Tout est presque parfait. Une louche de sauce, qui embaume déjà, va rejoindre le sang. On fouette gentiment, on reverse, on réchauffe à feu doux, en se gardant du moindre début d’ébullition. J’ajoute, à cet instant et sur ce plat unique, une cuillerée de cacao. Amer, non sucré. Histoire de renforcer encore les fragrances. Chacun se sert, à la cuillère, en retenant son souffle, en fermant les paupières…